Photo : Sous 42°, sur le site du temple khmer Phanom Rung (Thaïlande, avril 2019).
* Ce titre fait référence au best-seller de développement personnel de Brian Tracy, Eat that frog !, traduit en français par Avalez le crapaud ! Qui veut dire, en gros : débarrassez-vous de ce que vous n’avez pas du tout envie de faire MAIS QUE VOUS DEVEZ FAIRE, dès que vous vous levez. Ne repoussez pas à plus tard. Eat the frog. Faites-le à votre réveil, et vous passerez une bien meilleure journée.
∼∼∼∼∼
Un voyage au long cours est ponctué de moments durs et de moments de grâce.
Le nôtre n’échappe pas à la règle.
J’ai l’impression de souvent vous parler de ce qui est difficile.
Peut-être parce que je râle trop, comme tous les commentaires de Français sur le site de Booking – pour une même guesthouse, comparer les commentaires de satisfaction de Français et de Québécois est riche d’enseignements sur la culture de chaque pays et la façon dont on est élevés, à voir systématiquement le négatif ou à plutôt essayer de positiver les choses. Enfin…
Peut-être aussi parce qu’on écrit moins sur ce qui va bien. On dit moins quand on aime que quand on n’aime pas. Quoique, moi je dis.
Même si, souvent, ça sonne bizarre aux oreilles des autres et je sens que je suis mal comprise.
Mabel is not crazy. She’s unusual.
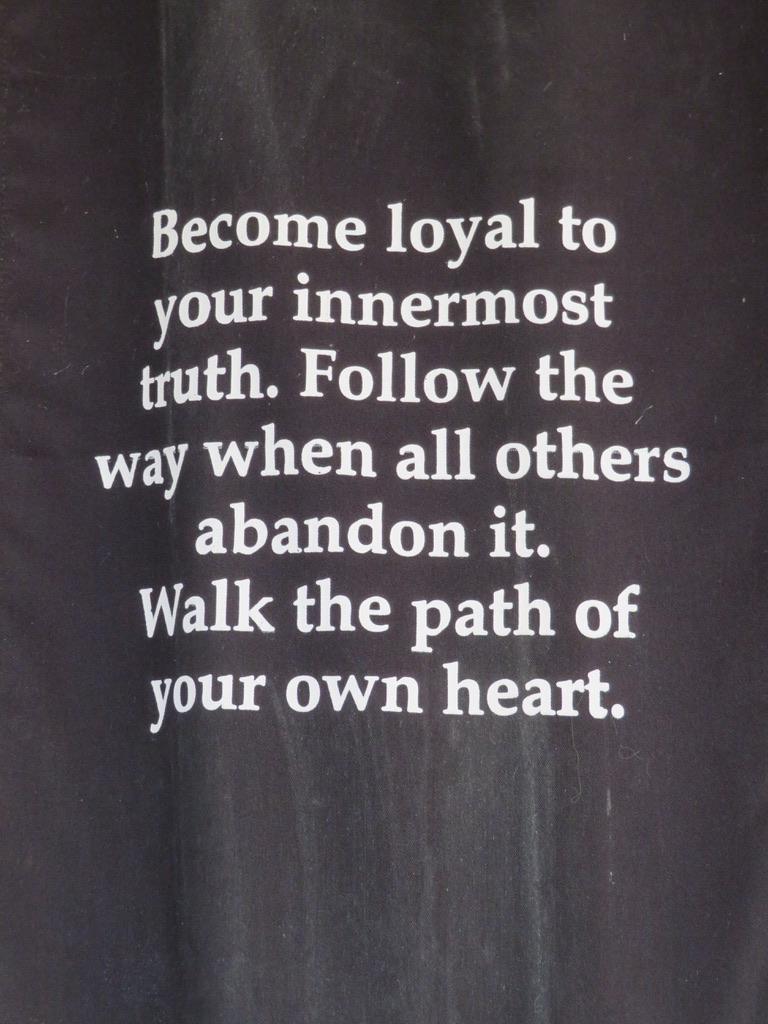
Comme avec cette jeune Australienne rasée, à Bowen en Australie, au moment où on a compris qu’on n’avait pas d’autre choix que de faire demi-tour à cause de la mousson débordante.
– You’re so beautiful !, je lui ai dit.
C’est sorti tout seul. Il y a eu un instant de flottement. Je ne la connaissais pas, elle venait juste d’arriver avec son amoureux dans le bureau d’information des routes inondées et me frapper de toute sa beauté.
– Tu sais pas ce qui se dit et ce qui ne se dit pas, m’a dit Mickaël en me tirant par le bras.
Peut-être. Sûrement même.
Mais je sais ce que moi je dis ou ne dis pas. (Et elle était vraiment belle.)
Alors, depuis plusieurs semaines que j’y pense, à écrire cet article sur les babi qui s’adaptent de mieux en mieux au voyage, aujourd’hui je m’y mets. Pendant qu’ils travaillent l’école avec Papa Écureuil, dans des conditions un peu meilleures que ces derniers temps. Sur les lits, parce qu’il n’y a toujours pas de table, mais à la clim’ déjà. Sous 40°, ce n’est pas un détail.

Y’en a encore beaucoup des crapauds là ? (le Grand Lièvre, 7 ans)
Quand quelque chose est difficile, je dis aux babi : avalez le crapaud. Entier, avec les yeux, les pattes et tout, vous verrez comme on se sent mieux après. C’est comme boire un verre de nigari le matin à jeun, vous avez l’habitude maintenant. Vous le buvez, tous.
Bon. Je ne vous cache pas que certains se sentent très bien avant et ne voient pas POURQUOI, justement, ils devraient se forcer à gober un crapaud – par exemple en conjuguant le verbe « mettre » au passé simple, ou en calculant le temps de trajet en bus qu’il nous reste sachant que nous avons déjà parcouru un tiers de la distance – tout ça pour être mieux après.
– Ben parce que sinon le crapaud te regarde. Toute la journée il reste là, à te regarder avec ses gros yeux.
– Bah moi je m’en fiche qu’il me regarde ! Ça me gêne pas s’il reste là…
Ça se défend, j’imagine. Mais moi j’avale, donc je ne suis pas tolérante avec celles et ceux qui ne vont pas jusqu’au bout. De l’exercice, du problème, du voyage, des règles que l’on se fixe. Bref.

Avec mes enfants, je suis encore plus exigeante. Je ne le fais pas exprès, ça me vient comme ça. Je ne veux pas qu’ils soient étriqués dans leur vie. Je ne veux pas que la peur – ou, encore pire, la paresse – les empêche de réaliser leurs projets, leurs rêves.
En voyage, chaque jour ils se rendent compte qu’il existe d’autres façons de vivre que la nôtre. Bien sûr. Mais on les pousse aussi, physiquement, mentalement, dans les limites de leur résistance.
Marcher encore pour aller chercher de l’eau quand on a déjà marché deux heures sous le soleil. Traverser un chemin où traînent les chiens errants quand on a peur des chiens.
Je n’ai aucun plaisir à les voir souffrir, mais je trouve que c’est important pour eux, dans leur construction d’adulte, qu’ils sachent qu’ils sont capables de faire quelque chose qui leur paraît d’abord difficile. Qui leur demande un effort. Ils peuvent le faire. Ils ont toutes les ressources en eux, et nous sommes là pour les accompagner, Papa Écureuil et moi.

« L’effort est pénible, mais il est aussi précieux, plus précieux encore que l’œuvre où il aboutit, parce que, grâce à lui, on a tiré de soi plus qu’il n’y avait, on s’est haussé au-dessus de soi-même. »
C’est Bergson, dans L’Énergie spirituelle. Notez que je ne suis pas en train de lire Bergson hein, on ne fait pas de la philosophie avec les neurones grillés au soleil. Mais il est cité par Fréderic Lenoir dans La Puissance de la joie (pp.89-90 de l’édition en Livre de Poche, si vous êtes à fond), et moi évidemment quand je tombe là-dessus, ça résonne très fort, rapport au courage et à la persévérance qui sont mes grandes batailles.
C’est de l’eau au moulin de ce que j’essaye de transmettre à mes enfants. Et ça me semble vraiment important. Pouvoir se dire, après coup : j’ai fait ça. J’avais peur – ou bien : c’était dur – mais j’ai fait ça. Moi tout(e) seul(e). Je suis capable.

Donc, comme visiblement le sens de l’effort n’est pas inné à tout le monde, on les pousse. Les babi. On les traîne dans les vestiges des temples khmers du nord-est de la Thaïlande sous 42° la veille de Songkran, le jour le plus chaud de l’année.
Le boutoir du Marcass’
J’aime pas Songkran parce que j’ai peur qu’on doive se raser pour montrer son crâne…
Il n’y a personne, à peine quelques Chine-touristes sur le premier site de Phanom Rung. Mais sur le second, au Prasat Meuang Tam, nous sommes complètement seuls. Il fait une chaleur de dingue, et, unexpected, le moment de grâce se produit. Les ruines deviennent un immense terrain de jeux, rempli de recoins et de super cachettes.
– Regarde le passage secret que Lulu a trouvé, on arrive dans les murailles du château !

Les babi disparaissent de notre champ de vision, explorent ces lieux historiques à leur façon.
Ils ramassent toutes sortes de graines et de tiges inconnues pour mettre au point des potions. (C’est ça en voyage quand on n’a pas de jouets… Voilà comment est né l’awélé !).

Et puis, bien sûr, nous avons tous aimé notre halte surprise pour mon anniversaire à l’hôtel-méga-luxe-de-Luang-Prabang comme disent les babi, au Laos. Mais ce n’était qu’une belle parenthèse dans la vie en vrai (pour reprendre les titres de deux magnifiques chansons d’Anne Sylvestre).
Un endroit extra-ordinaire qui ne correspond ni à notre budget, ni à notre façon de voyager.
Ce matin, le Marcass’ est venu se coller contre moi dans mon lit, et, parce que notre expérience cambodgienne est éprouvante, physiquement, moralement, nerveusement, chaque jour passer devant des tas d’immondices qui prennent à la gorge sur plusieurs mètres, la chaleur extrême, la saleté, la poussière partout, il m’a dit :
– Je serais bien resté un an dans l’hôtel de luxe. Celui où il y avait le camembert au petit-déjeuner, la baignoire dehors, et le grand hamac pour nous deux à côté de la piscine.

Oui, moi aussi. Mais ce n’est pas notre réalité.
Au quotidien, l’absence de confort fait partie du voyage. On ne vit pas dans une bulle.
Sans être dans la vie des gens, parce qu’on ne peut pas, on côtoie cependant un morceau de leur réalité à eux. On mange la même chose, on emprunte les mêmes transports, on suit les mêmes routes – même si pour nous, elles ne sont que transitoires.

J’entends par absence de confort :
la crasse, les bus locaux aux banquettes complètement défoncées, les toilettes à l’extérieur de la chambre (sans clim bien sûr) couvertes de fourmis, un lavabo à l’extérieur aussi mais ça fait rien parce que y’a pas d’eau qui coule dedans, les serviettes qui puent, les draps sales, les lits cassés pliés en leur milieu, les énormes cafards, les mouches qui se collent sur nous dans la sueur, les rats qui courent devant la porte, la douche carrément sur les toilettes, sur 1 m2, tu te contorsionnes autour pour te laver comme tu peux.
Ne pas jeter le papier dans la cuvette. Si t’as de la chance et qu’il y a du papier.

Et rien à manger à moins de vingt minutes de marche dans la nuit, sans trottoirs ni éclairage public (attention aux trous sur la route et aux chiens errants qui surgissent brusquement).
Pour une assiette de riz frit bien sûr. Le même riz frit qu’on mange depuis des semaines et des semaines, parce que c’est tout ce qu’on trouve de pas pimenté pour les babi sur les échoppes de bord de route… On n’est pas en train de parler du poulet rôti français de mounette ou de mamie dont ils rêvent la nuit !

Bon, là c’est vrai qu’à Nang Rong, on a cumulé. En plus les babi dormaient dans une chambre loin de nous sur des matelas sans rien, sans toilettes, sans clim, il devait faire 35° là-dedans…
Le plus souvent, on n’a pas tout ça en même temps. Heureusement.
Néanmoins, il est évident que notre façon de voyager ces derniers temps en Asie du Sud-Est, notamment dans le nord de la Thaïlande et au Cambodge, est bien plus difficile qu’au Sri Lanka où on a toujours dormi dans des endroits corrects. Et pourtant, les babi supportent mieux.
Comme quoi c’est sûrement un peu vrai qu’on s’habitue à tout. (Même si je déteste les phrases toutes faites.)

Les babi supportent mieux, mais c’est vrai que quelquefois c’est vraiment rude. Chez nous on dit qu’ils font le job.
They eat that frog !
Le plus pénible qu’on ait connu, en termes de degrés Celsius, c’est Angkor, au Cambodge. 45° à l’ombre. J’ai du mal à imaginer qu’on puisse supporter plus chaud. Mais sûrement que si, on peut.
Y’a toujours plus profond que le fond.
Bien sûr on sait qu’il fait chaud. On est partis tôt. Mais à 8h du matin sur le site d’Angkor Vat, il fait déjà 38°. À l’ombre toujours.
Là, on les a vraiment poussés. Je veux dire, quand tu entends ton enfant de cinq ans à bout de force continuer à poser un pied devant l’autre et murmurer, comme pour lui-même : « j’vais crever… », c’est que tu les as amenés trop loin déjà. Beyond the limit (c’est une zone que je connais pas mal).

Mais ils n’osent pas trop se plaindre parce que ce serait facile de leur renvoyer dans la face la misère des enfants en haillons que l’on croise sur les sites des temples khmers. Ceux qui sont pieds nus sur la terre brûlante à vendre des trucs. Des « souvenirs ».
Vendre des souvenirs. La juxtaposition des deux termes me heurte à chaque fois.
Les babi ont vu une petite fille de l’âge du Marcass’ sautiller avec son panier chargé de, « souvenirs » donc, pour ne pas se brûler les pieds sur le sol.
J’ai pas pu m’empêcher de lâcher :
– Bon bah, cette petite fille que vous voyez, c’est sûr qu’elle ne va pas à l’école.
[Le taux d’alphabétisation au Cambodge est de 75%.]
À quoi le Marcass’, en train de crever donc, a répondu de lui-même :
– Ouais moi je préfère carrément aller à l’école. Même au CP.
C’est dire.

Rien pour écrire à sa mère (Gabriel, 36 ans)
Enfin donc, ça transpire sans que ça glisse forcément comme dans ta Benz.
Mais ça va. Rien pour écrire à sa mère.
(Est-ce que cette expression québécoise n’est pas merveilleuse ? Je me demande dans quelle mesure je n’ai pas écrit tout le début exprès pour pouvoir la passer ! Rien pour écrire à sa mère, j’adore !)
Nous avons notre rythme de voyage, à cinq, et nous trouvons chacun notre place dedans.
Il faut dire aussi qu’on s’est beaucoup assouplis, Papa Écureuil et moi. On offre un Coca aux babi de temps en temps, sans qu’ils le réclament, on prévoit la piscine après les temples et une noix de coco fraîche pendant, pour tenir. Pour pas qu’ils s’écroulent.

On SAIT ce qui leur plaît dans le voyage : chercher des animaux, étudier des cartes géographiques, compter les marches des escaliers, jouer avec des bâtons, escalader des rochers, grimper aux arbres, se baigner dans une cascade, prendre un tuk-tuk, suivre un chemin sur un plan pour nous guider…
Et surtout : ne pas avoir de programme.
Ils aiment savoir qu’ils auront du temps pour eux, qu’ils pourront lire, aller à la piscine, jouer avec les Lego providentiels d’un enfant qu’on rencontre, faire des glissades sur les toboggans gonflables (là, un Québécois entend « faire des toboggans sur les toboggans », c’est weird…), et regarder des dessins animés sur la tablette.
Oui. Je vous en parlerai dans la deuxième partie de cet article. 😉

De notre côté, on n’a plus besoin de se rassurer qu’ils vont pouvoir tenir le voyage. On EST dans la partie la plus difficile et on voit qu’ils tiennent, du coup on lâche davantage.
Je trouve que c’est très similaire à la différence de souplesse avec laquelle on élève nos enfants quand on en a plusieurs. Avec le premier ou la première, on se positionne en tant que parent. On a l’impression que tout l’avenir de notre enfant dépend de nous et uniquement de nous, de la solidité des règles que l’on fixe et de la rigueur avec laquelle on s’y tient.
On a surtout besoin de prendre confiance en soi.
Avec le deuxième enfant, et encore plus avec le troisième, et j’imagine les suivants, on n’a plus rien à prouver à personne. On sait quel parent on est, et que c’est pas parce qu’on cède sur une double ration de bonbons ou de chocolat qu’on perd respect et légitimité.

Peut-être que mon exemple vous semblera bizarre, ou juste ne vous parlera pas – surtout si vous n’avez pas d’enfants 😉 – mais pour moi le parallèle entre les deux situations est patent.
Au Sri, à Bali, on était tendus dès que les babi se plaignaient de quelque chose. On craignait qu’ils ne supportent pas la rudesse du voyage, la chaleur, la faim, la soif, la fatigue. En retour, on se montrait durs avec eux, on les disputait, on ne leur passait rien…
Maintenant, après six mois, on sait qu’ils tiennent. On sait qu’ils supportent, qu’ils sont capables.
Ils nous ont prouvé, tous les trois, qu’ils avalent le crapaud. Parfois ils grimacent, ils se bouchent le nez, mais ils avalent.
Et on est beaucoup plus souples avec eux. On fait attention de ne pas se laisser embarquer dans un rythme trop soutenu, et on compense les journées longues et difficiles par des journées qu’on appelle « à la cool ».
Parfois, en fonction de ce qu’on fait, il y a même un joker pour pas d’école…

La suite ici !
Ou comment lâcher suffisamment pour que tes enfants finissent par EMBRASSER le crapaud…
*****
Pensez-vous aussi que pousser vos enfants, en les accompagnant bien sûr, à affronter leurs peurs ou à s’aventurer sur des terrains où ils n’auraient jamais osé aller par eux-mêmes, peut les aider à prendre confiance en eux et à faire grandir leur estime d’eux-mêmes ?
Ou pas du tout, au contraire, et vous nous trouvez méchants et cruels ??





